Créé en 2004 avec la Route bleue du sud de l’estuaire, le Sentier maritime du Saint-Laurent
fête cette année ses 10 ans d’existence. L’occasion de faire un bilan
de santé du sentier, qui compte aujourd’hui neuf routes bleues sur les
deux rives du fleuve. Et le résultat n’est pas à la hauteur des
espérances...
Jean Létourneau, kayakiste passionné, fut l’un des instigateurs de la
création du Sentier maritime, via la Route bleue du sud de l’estuaire,
au début des années 2000. Il est donc bien placé pour jouer au médecin
et en faire le bilan : « Le Sentier maritime est dans une phase
compliquée, voire mauvaise. Sa création devait initialement répondre à
plusieurs objectifs, notamment la mise en valeur du fleuve et son
accessibilité par les kayakistes. Beaucoup d’efforts ont été faits pour
la création et le développement des Routes bleues avec leurs
infrastructures : les abris, les aires de repos, les services. Mais, une
fois l’étape de la mise à l’eau, très peu a été fait pour les
pérenniser et faire en sorte que les communautés du fleuve
s’impliquent. »
Le constat est clair : le Sentier maritime du Saint-Laurent ne se porte
pas bien. Si Jean Létourneau a déjà donné quelques pistes de réflexion,
plusieurs points peuvent être soulevés pour expliquer cette situation
« compliquée ».
1. Désinvestissement des politiciens et du ministère du Tourisme
Initié en 2002 par le ministre André Boisclair dans le cadre de la
Politique nationale de l’eau, le Sentier maritime du Saint-Laurent est
le fruit d’une collaboration entre la Fédération québécoise du canot et du kayak
(FQCK) et Tourisme Québec. Le ministère du Tourisme donnait ainsi le
mandat à la FQCK d’assurer la gestion globale du Sentier maritime et de
l’uniformisation des différentes Routes bleues, développées par les
comités de développement régional. « La FQCK travaille en partenariat
avec Tourisme Québec afin de créer des outils de développement pour les
nouvelles Routes bleues », peut-on lire sur le site internet du Sentier
maritime. Or, comme l’explique Philippe Pelland, directeur général de la
FQCK : « Depuis quelques années, le Ministère s’est progressivement
retiré de la politique nationale de l’eau ». La Fédération se retrouve
dans une situation difficilement tenable : assurer une mission de
coordination et d’uniformisation, sans budget alloué pour le réaliser.
« Depuis un an, nous n’avons plus personne au poste de coordination.
Tourisme Québec est encore notre partenaire, mais on est loin du compte
pour permettre une embauche ». Il regrette cette logique comptable des
décideurs : « Le financement du sentier est ponctuel, car ils le
considèrent comme un vecteur économique pas assez important à l’échelle
du Québec ».
Une réalité que confirme Pierre Gaudreault, président d’Aventure Écotourisme Québec
: « Les moyens financiers n’ont jamais été à la hauteur de ce grand
projet de mise en valeur du Saint-Laurent. On a donc un projet
structurant, mais difficile à être viable à long terme. Il n’y a jamais
eu de mise en marché du sentier, ce qui aurait permis le déblocage de
fonds. Ça a été le cas avec la Route verte pour le vélo à coup de
plusieurs millions de dollars du ministère des Transports. Pour la Route
bleue, on parle de quelques milliers de dollars. Faute d’argent, tout a
été fait grâce avec des bénévoles ». Mais les bénévoles ne sont pas une
ressource inépuisable et ces gens passionnés, malgré un gros travail,
commencent à s’essouffler et les effectifs s’amoindrissent. Roger De La
Durantaye, président du Conseil d’administration de la Route bleue de la
rive sud de l’estuaire, le confirme : « C’est épuisant d’être bénévole,
surtout depuis que les ressources de la fédération ne sont plus là.
Cela permettait d’avoir un support, un lien avec les autres routes
bleues. Aujourd’hui, on est comme coupé les uns des autres. C’est
difficile au quotidien ».
2. Manque d’investissement de la population
 Jean
Létourneau pointe du doigt un état d’esprit propre au Québec : « La
culture québécoise n’est pas propice à la philanthropie. Chez nos
voisins américains, on supporte beaucoup de causes. Au Québec, le
réflexe des utilisateurs du sentier est plutôt du type : “Le fleuve est
là. Pourquoi devrais-je payer 40 dollars par an pour en devenir membre?”
La raison d’être du sentier est d’assurer un accès pérenne au fleuve,
mais cela ne semble pas avoir beaucoup d’importance dans l’esprit des
Québécois. Résultat : on a seulement environ 250 membres. Faites le
calcul. Cela fait trop peu pour assurer un revenu notable ». « Le fleuve
est un très bel atout. Ce n’est pas un juste un cours d'eau, assure une
compagnie membre et adhérente de la Route bleue du sud de l’estuaire,
qui préfère rester anonyme. Il est imprévisible et tellement varié! On
ne peut pas dire que c’est fade! La faune, avec tous les mammifères
marins, y est intéressante à observer. Il y a de très beaux coins pour
respirer. Mais il faudrait que les kayakistes accaparent davantage cet
espace ».
Jean
Létourneau pointe du doigt un état d’esprit propre au Québec : « La
culture québécoise n’est pas propice à la philanthropie. Chez nos
voisins américains, on supporte beaucoup de causes. Au Québec, le
réflexe des utilisateurs du sentier est plutôt du type : “Le fleuve est
là. Pourquoi devrais-je payer 40 dollars par an pour en devenir membre?”
La raison d’être du sentier est d’assurer un accès pérenne au fleuve,
mais cela ne semble pas avoir beaucoup d’importance dans l’esprit des
Québécois. Résultat : on a seulement environ 250 membres. Faites le
calcul. Cela fait trop peu pour assurer un revenu notable ». « Le fleuve
est un très bel atout. Ce n’est pas un juste un cours d'eau, assure une
compagnie membre et adhérente de la Route bleue du sud de l’estuaire,
qui préfère rester anonyme. Il est imprévisible et tellement varié! On
ne peut pas dire que c’est fade! La faune, avec tous les mammifères
marins, y est intéressante à observer. Il y a de très beaux coins pour
respirer. Mais il faudrait que les kayakistes accaparent davantage cet
espace ».
Le sentier maritime a pourtant été créé sur le modèle du Maine Island
Trail, une route navigable de 520 kilomètres, géré par le Maine Island Trail Association
(MITA), une organisation forte de 4 000 membres et plusieurs centaines
de bénévoles. Sophie Marois, professeur en tourisme d’aventure au Cégep
Saint-Laurent, en a longtemps été une membre active : « Le MITA connait
aussi des difficultés, mais cela fonctionne quand même. C’est une
machine très bien organisée avec beaucoup de kayakistes qui empruntent
cette route. Malgré les nombreux terrains privés, son développement
s’est fait avec l’appui des populations terrestres et nautiques. Chacun y
a trouvé son compte. Au final, cela fait une culture du kayak bien
vivante au Maine. Ce n’est pas le cas ici au Québec. La culture du plein
air est encore jeune. »
3. Le retrait de Boréal Design
En
février 2012, le manufacturier québécois Boréal Design, spécialisé dans
la fabrication d’embarcations de mer et commanditaire des Routes
bleues, déclarait faillite. Le Sentier maritime perdait alors un
allié précieux dans la promotion du kayak de mer, une locomotive
économique qui tirait cette activité vers le haut en commanditant
notamment des événements régionaux à portée internationale. Ce fut le
cas avec l’organisation des Championnats du monde de kayak de mer, de
Forestville à Sainte-Luce, en 1999. Certains cadres de l’entreprise y
ont même pris part comme athlètes. À tel point que certains parlent
d’une « Famille Boréal Design » qui rassemblait et fédérait, autour
d’eux, tous les acteurs du monde du kayak : les clients et les
pratiquants, les pourvoyeurs, les instances dirigeantes.
Si la compagnie a été rachetée par Kayak Distribution, il semblerait
que cette famille n’ait pas survécu à la faillite. Comme l’explique
Roger De La Durantaye : « On n’est plus aussi proche avec les nouveaux
propriétaires. L’administration que l’on connaissait croyait au kayak de
mer. Je ne dis pas que ce n’est pas le cas avec l’actuelle
administration, mais leurs prédécesseurs offraient plus de visibilité.
Ils croyaient fort au développement des Routes bleues. Avec la faillite
et le rachat de Boréal Design, on a perdu un acteur important, fort
impliqué ».
4. Un fleuve difficile à naviguer
Comme le fait remarquer Louis Dubord, copropriétaire de la compagnie
d’aventure Fjord en Kayak : « Le Saint-Laurent n’est pas facile à
naviguer. Au niveau de l’estuaire puis du Golfe, la difficulté est assez
avancée. Il faut avoir un certain niveau. Ce n’est pas pour les novices
ou même les kayakistes de niveau intermédiaire, mais bien pour les
experts ». La clientèle visée est donc plus limitée.
La Route bleue du Grand Montréal est plus accessible et semble mieux
s’en sortir. « Pour cette zone, on a beaucoup de téléchargements de
cartes sur notre site », assure Philippe Pelland. « Le Tour de l’Île
Bleu, organisé depuis trois ans, constitue une belle vitrine pour la
Route bleue. Elle devient plus accessible au grand public. Ce sentier de
navigation s’insère dans un bassin de population important et moins
dépendant des marées ». Les variations du niveau de l’eau, notamment sur
la Rive-Sud du Saint-Laurent, et les conditions climatiques sont aussi
des éléments importants qui affectent grandement la pratique du kayak de
mer.
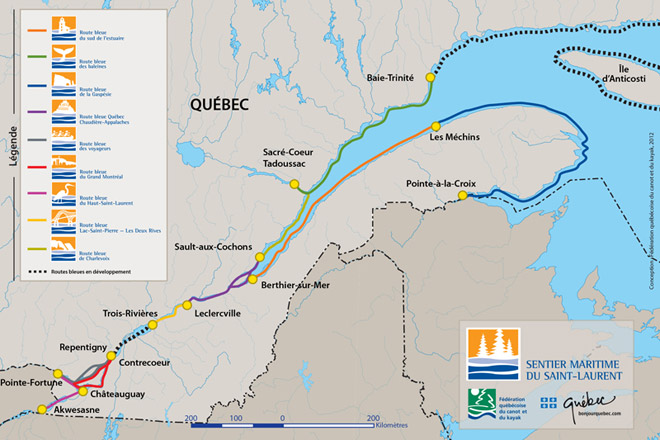
5. Une activité en concurrence
Selon Pierre Gaudreault : « De nombreuses activités de plein air
émergent et se développent d’année en année. Il y a donc de plus en plus
de parts au même gâteau. Par exemple, au début des années 2000, il n’y
avait pas de via ferrata au Québec. Ces dernières se sont
développées un peu partout et on en compte aujourd’hui une trentaine! »
Sans oublier que le kayak de mer demeure une activité plus dispendieuse
que d’autres, et demande un investissement et une organisation plus
lourde : un kayak de mer mesure environ cinq mètres de long. Pas commode
à transporter dans des zones moins accessibles ou encore à ranger dans
son salon…
Alors, quel avenir pour le sentier maritime ? Cette mauvaise passe du
Sentier maritime n’est pas inéluctable : « On a un produit récréatif et
touristique exceptionnel », confie Roger De La Durantaye. « On ne lance
pas la serviette. On réfléchit à un autre modèle pour assurer la
pérennité du sentier. Au printemps 2013, on a notamment fait appel aux
municipalités pour des collaborations financières. Les MRC pourraient
également prendre le relais. »
Sylvie Marois envisage une solution plus radicale : « On doit relancer
sur les éléments forts du sentier. Ne pas hésiter à faire la part des
choses et se demander là où ça fonctionne et là où ça ne fonctionne pas.
Il faut investir dans les portions les plus intéressantes, celles qui
valent vraiment la peine. Mais ça prend l’appui du monde terrestre avec
des accès à leur terrain privé ». Pour Jean Létourneau, une chose est
sûre : « Il faut se réinventer. Sinon ce sera la fin du Sentier
maritime. Aujourd’hui, le gouvernement a des plans quant à l’utilisation
et l’appropriation du fleuve. Il faut profiter de cette récente
politique touristique pour insuffler un vent nouveau ».

